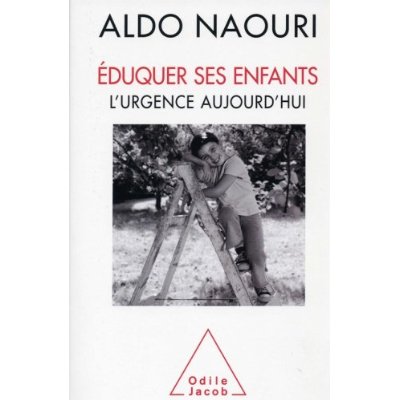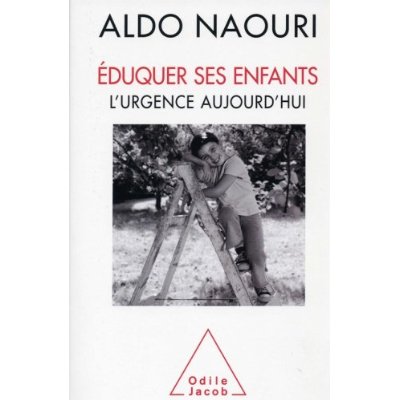
Naouri écrit que, s'agissant de l'éducation, tout est est joué à trois ans. Il n'y a pas de raisons qu'une éducation partie sur de mauvaises bases s'arrange par la suite.
Si un enfant de trois ans est mal élevé, pourquoi serait-il bien élevé à dix ans ?
Beaucoup des enfants d'aujourd'hui, je dirais la majorité au pifomètre, sont mal élevés, dans tous les sens qu'on peut donner à ce terme significatif.
Naouri attribue cet état de fait à deux phénomènes :
1) la contraception : l'enfant n'est plus le sous-produit plus ou moins accidentel du désir sexuel de ses parents mais il est voulu. Avant, l'enfant n'était qu'un élément, et mineur, là aussi dans tous les sens du terme, du couple, on était le fils ou la fille de M. et Mme Tartempion. Maintenant, l'enfant est le centre du monde. Ce sont M. et Mme Tartempion qui sont vus comme les parents du petit Gustave.
Or, quoiqu'on dise et qu'on fasse, l'enfant est un être inférieur, il n'est pas pleinement développé, c'est le but même de l'éducation que de permettre ce développement. Il n'est pas apte à être le centre du monde.
2) le mouvement d'égalité des sexes.
Ce double mouvement conduit à une maternalisation de l'éducation, à mon goût et visiblement à celui de Naouri, excessive.
Les pères ne sont souvent que des mères-bis. Naouri cite l'exemple pathologique d'un père qui demandait à sa femme de tirer son lait pour nourrir lui-même son bébé au biberon et qui, pour cette cérémonie, revêtait la chemise de nuit de sa mère !
Combien vois-je de pères qui n'osent pas s'interposer entre la mère et l'enfant, empêchant celui-ci de prendre son envol ?
Naouri exprime très bien les différents rôles en une phrase : la mère est vivifiante à court terme (elle donne de l'assurance à son enfant) et mortifère à long terme (elle l'empêche de prendre son envol, de grandir) et le père est mortifère à court terme (il sépare la mère et l'enfant) et vivifiant à long terme (il aide l'enfant à grandir, à devenir lui-même, autonome, libre et responsable).
C'est à la mère de faire une place au père dans sa relation avec l'enfant et au père de la prendre, cette place.
La vie est dure, frustrante, tout simplement parce qu'elle se termine par la mort. C'est aux parents d'apprendre à leurs enfants la frustration pour qu'ils puissent assumer leur vie, trouver un équilibre.
Le danger est d'entrer dans une relation de séduction avec l'enfant («Dis à maman que tu l'aimes» ; «Si tu n'es pas gentil, maman ne t'aimera plus»). C'est une relation très malsaine : l'amour entre parents et enfants n'a pas à se mériter, à se justifier, sinon il est fragilisé. Cette relation de séduction est un plaisir égoïste de l'adulte qui évite ainsi d'assumer la part désagréable de son rôle.
Les parents doivent l'éducation à leur enfant. La séduction, c'est entre adultes.
Je connais deux femmes qui «ont fait des bébés toute seules» (cette expression, par sa fausseté, est très significative : justement, on ne fait jamais de bébé tout seul). Ce sont donc des mères qui nient le rôle du père. J'en ai entendu une le dire très clairement : «Un père, ça ne sert à rien» et aussi «Dis moi que tu me préfères à papa (1)» (avec tout de même, une hésitation, elle sentait qu'il y avait quelque chose qui clochait dans une telle demande).
Je ne peux que trouver dans les enfants ainsi produits la confirmation de ce que raconte Naouri : ces mères cherchent dans leur relation avec l'enfant une consolation affective qu'elles devraient chercher avec un adulte.
Et cela fait des enfants collants, capricieux, versant facilement dans le chantage (si tu me dis «non», je me jette par terre et je me fais mal). Tous les enfants peuvent manifester ces tendances, sauf que, dans ces cas, elles ne rencontrent pas d'obstacle.
Je n'ai jamais vu ces mères dire définitivement «non». Au bout d'une certaine quantité plus ou moins grande de larmes et de cris, elles finissent toujours par céder. Elles culpabilisent de devoir se séparer de leur enfant, de le frustrer. Bref, il leur manque un père pour remettre de l'ordre dans cette relation fusionelle.
Bizarrement, (mais est-ce vraiment bizarre ?), l'un de ces petits que je vois assez régulièrement ne semble pas outre mesure me détester, au contraire, bien qu'il ne soit pas le centre de mon monde, qu'il ne me commande pas et que mon «non» ne se transforme pas en «oui», même après une dose massive de comédie.
Naouri considère que, pour ainsi dire, les enfants n'ont jamais de problème psychologique propre, que leurs problèmes ne sont que le reflet de ceux de leurs parents, qu'il suffit en général de traiter le problème des parents pour que l'enfant aille mieux.
Je suis assez enclin à le croire de par ce que je vois autour de moi. Je ne suis pas psychologue, mais certains comportements me mettent mal à l'aise, je sens bien qu'il y a quelque chose qui cloche.
Quand j'entends, comme ça m'est arrivé une fois dans le métro, une mère expliquer longuement à son jeune fils, pas plus de cinq ans, à l'évidence turbulent voire violent, pourquoi elle lui a dit non, je ne peux m'empêcher d'avoir pitié de ce gosse plongé dans les raisons complexes des adultes alors qu'il serait tellement plus simple, et donc plus rassurant pour lui, qu'un «oui» soit oui et qu'un «non» soit non.
Je me dis que ce n'est pas l'enfant qui déconne, c'est la mère.
De plus, ces relations malsaines de séduction et de faux nivellement (non, maman ou papa ne sont pas au même niveau que bébé) sont physiquement dangereuses : il y a le risque très réel que ces parents dans une situation fausse, qui dépensent tant, et si inutilement, et même si nuisiblement, d'énergie et de temps à se justifier et à négocier avec l'enfant-roi capricieux, le décalquent contre le mur le jour où ils seront un peu plus fatigués, stressés ou pressés que d'habitude, et que jaillira d'un coup toute la colère accumulée chez l'adulte depuis des années à se justifier sans cesse devant un enfant. Je l'ai vu une fois, donc ce risque n'a rien d'imaginaire.
Le problème des places est pourtant limpide : l'enfant n'est pas un adulte, il est, j'y reviens, mineur.
Une fois, j'ai eu le malheur d'affirmer dans une conversation que l'enfant était un être inférieur. Que n'avais-je pas dit là ! J'ai eu beau citer des exemples flagrants de son infériorité physique, intellectuel et social, je n'ai pas échappé au qualificatif de bourreau d'enfants. Je me suis donc tu sur la suite de ma pensée, à savoir que, considérant l'enfant comme un enfant, c'est-à-dire comme ce qu'il était, je le respectais probablement plus que tous ces adultes aux idées soit-disant avancées.
Je soupçonne chez ces adultes qui nient la spécificité de l'enfant la peur de vieillir : si l'enfant n'est pas tout à fait un enfant, nous ne sommes pas séparés, et donc je ne suis pas tout à fait un adulte.
Fidèle à mon comportement d'emmerdeur, quand des mères s'extasient sur le thème «Comme c'est mignon, il ne faudrait pas que ça grandisse», je reprends en général la balle au bond en rétorquant quelque chose comme «Au contraire, il faut souhaiter qu'il grandisse, c'est ce qui peut lui arriver de mieux», ce qui a le don de mettre mes interlocutrices mal à l'aise car ma réponse révèle leur part d'égoïsme, leur désir de ne pas vieillir, qu'elles projettent sur leur enfant.
Mes fidèles lecteurs ne seront pas étonnés que je rejoigne tout à fait Naouri quand il met le fond des problèmes de l'école au compte de cette volonté de refuser de constater et de traduire dans l'institution la hiérarchie entre le professeur et l'élève, qui existe de fait.
Enfin, Naouri a une solution pour mettre fin à l'infantolâtrie (l'expression est sienne) et retrouver une écucation équilibrée : passer de «l'enfant d'abord» à «le couple d'abord».
Le couple, et le jeu de tension-attirance en son sein, est premier, l'enfant n'en est qu'un sous-produit et c'est dans cette situation, où il est éduqué comme le résultat d'une relation entre ses parents et en fonction de l'interaction entre ses parents, qu'il trouve son équilibre.
Une digression sociale : dans l'aristocratie et dans la bourgeoisie, le fait d'avoir un nom ou un patrimoine à transmettre aide à l'éducation. L'enfant a quelque chose de plus grand que lui (le nom, le patrimoine) qui fait qu'il s'intègre à une histoire, il n'est pas unique et centre du monde. Bien sûr, ça ne veut absolument pas dire que tous ces enfants sont mieux éduqués, ça veut juste dire qu'ils ont une chance en plus de l'être.
Naouri donne des conseils qui peuvent choquer au premier abord : supprimer sans barguigner tétine et doudou à deux ans. Mais cela est-il plus choquant que ces adolescents qui ont encore leur doudou ? Naouri a souvent une attitude «il faut ce qu'il faut et ce n'est pas la peine de tourner autour du pot». Quand on a bien intégré qu'il faut pousser l'enfant à grandir et non l'aider à rester enfant, ça passe. Mais là encore, il faut être deux pour trouver un équilibre, j'imagine assez bien la mère défendant le doudou et le père prônant sa suppression.
Un psychiatre résumait cela en disant «C'est dans le lit des parents que se fait l'éducation des enfants», manière de dire que c'est parce que les parents ont une relation saine, épanouissante, confiante, sexuée, que l'éducation peut se dérouler correctement (2).
Je partage le pessimisme de Naouri : les forces poussant à l'infantolâtrie sont extrêmement puissantes et la société aura le plus grand mal à s'en défaire.
Deux exemples :
> une commission a été réunie pour donner son avis sur l'adhésion de la France à la charte internationale des droits de l'enfant. Les experts (jusristes, psychologues, etc ...) ont déclaré à l'uninamité qu'une telle adhésion était inappropriée dans le cas d'un pays avancé comme la France. Lors de la séance de remise du rapport, le premier ministre de l'époque, Michel Rocard, a signalé que le processus d'adhésion était de toute façon déjà entamé.
> un des nombreux rapports sur l'école a rendu un avis qui disait, ô miracle, que le problème fondamental était dans la dévaluation de la fonction paternelle. Qu'a fait le gouvernement Jospin ? Il a allongé la congé parental pour le père. Autrement dit, il est allé encore plus loin dans la transformation du père en une mère-bis ! Ce qui, bien évidemment, revient à renforcer le problème et non à le résoudre.
Cependant, l'éducation est une affaire personnelle, c'est au sein de chaque couple qu'elle se fait.
La société est peut-être foutue dans sa majorité, mais ça n'empêche pas les parents qui lisent ce blog, Naouri ou d'autres choses du même genre, ou qui, simplement, ont un peu de bon sens et quelques repères (3) d'essayer de donner une bonne éducation à leurs enfants.
(1) : qui vient de temps en temps voir son bébé en touriste.
(2) : c'est pourquoi l'expression «famille monoparentale» m'a toujours paru un oxymore. Pour moi, une famille avec un seul parent, ce n'est pas une famille (il en est d'ailleurs de même à mes yeux lorsque les deux parents sont d'une même sexe). Vous vous doutez bien que, chaque fois que j'ai affirmé cela, surtout en présence d'une mère célibataire ou divorcée (le cas d'un père célibataire élevant ses enfants ne s'est jamais présenté à moi), j'ai été obligé de changer rapidement de sujet, mon opinion soulevant une opposition immédiate, remuant trop de choses que je n'avais pas envie de prendre en charge en pousant mon argumentation.
(3) : n'oublions pas que ce que raconte Naouri, c'est en gros les relations familiales d'il y a une ou deux générations, il est donc normal que quelques couples subsistent à qui cet héritage a été transmis. En ce qui me concerne, ça me paraît la chose la plus naturelle du monde. Ce sont au contraire les couples «modernes» qui donnent une éducation «moderne» (c'est-à-dire, à mes yeux, déséquilibrée et égoïste) qui me semblent étranges.